[NATURE&PROGRES BELGIQUE – Valériane n°99, janvier-février 2013] Flore & Pomone est une association qui souhaite faire connaître au public les anciennes variétés de roses et de fruits de chez nous : pommes, poires et prunes, pour l’essentiel. Poursuivant à la fois un but conservatoire et didactique, elle promeut également les techniques qui permettent de les multiplier et de les cultiver. Petite visite dans le verger de l’association, à Enines, du côté de Jodoigne. Un tableau idyllique créé par Jean-Pierre Wesel, il y a trente-trois ans déjà !
La région de Jodoigne est riche d’un passé prestigieux dans le domaine de la pomologie et, plus particulièrement, de la création de variétés de poires. Le verger où nous nous rendons est situé à côté du champ voisin d’un fermier ‘conventionnel’, sur le flanc sud d’une butte, abrité au nord par une large haie de feuillus, de noisetiers principalement, étoffés d’une rangée de pruniers. Plus bas, s’étale la dizaine de lignes de plantation qui s’enrichissent chaque année avec de nouveaux scions et de nouvelles greffes. À l’heure actuelle, le verger de Flore & Pomone peut s’enorgueillir de posséder plus de quatre cent cinquante variétés de pommes, de poires et de prunes. Pour l’essentiel, des espèces à sauver en priorité… Car le but clairement déclaré est la sauvegarde d’un certain patrimoine génétique, mais surtout d’une diversité de couleurs, de saveurs et de parfums.
Genèse d’un verger conservatoire

“J’ai personnellement fait des études d’horticulture à Vilvorde, raconte Jean-Pierre Wesel, qui m’ont donné la passion pour les arbres fruitiers, ainsi que pour les roses, d’ailleurs, raison pour laquelle Flore s’est ajoutée à Pomone. Ce sont mes deux passions. Dans le courant des années septante, j’ai pu acquérir une maison à Enines ; j’y ai cultivé des variétés de fruits que j’avais acquises lorsque j’étais étudiant, constatant qu’elles disparaissaient purement et simplement. J’ai acheté le terrain en 1977, hésitant entre la création d’une grande roseraie historique et la mise en place d’un verger conservatoire. J’ai alors réalisé que les roses anciennes étaient bien protégées dans des roseraies de grand niveau, en Allemagne et en France ; j’ai constaté par contre que les variétés locales de fruits étaient beaucoup plus en péril, en plus grand danger de disparition que les roses. J’ai donc installé ce verger conservatoire en 1978-79 afin d’agrandir ma collection, année après année. J’avais déjà commencé tout près de ma pr0priété où je cultivais alors une trentaine de variétés. Tout cela sans le moindre engrais ni traitement chimique, cela va sans dire. Dès le départ, j’ai suivi une démarche identique à celle de Charles Populer, du côté de Gembloux, dont je fis la connaissance en 1978. Notre objectif est aujourd’hui d’obtenir une meilleure reconnaissance en tant que ‘duplicata’ des variétés spécifiques à la région de Jodoigne qui sont conservées à Gembloux. Nous aimerions proposer une collaboration plus étroite, tablant sur le fait qu’il serait intéressant d’entretenir ici un doublon pour tout ce qui concerne les variétés spécifiquement jodoignoises. Je suis aussi en recherche d’un lieu où créer une roseraie historique ; je suis actuellement en pourparlers dans la région d’Eupen. Nous travaillons d’ailleurs à compléter le site Internet de Flore & Pomone (floreetpomone.be) c·réé par notre présidente Françoise Van Roozendael, avec une large documentation concernant les roses. En 1989, j’ai donné une conférence intitulée Nos vergers, leur passé et leur avenir, à l’issue de laquelle j’ai fait appel à une équipe de bénévoles pour venir m’aider. Une quinzaine de personnes ont répondu ; nous avons ainsi créé une lettre de contact afin de tenir les gens intéressés au courant de nos activités et de leur prodiguer informations et conseils utiles. En 1994, le verger a reçu la visite de Claudine Brasseur et du Jardin extraordinaire de la RTBF, puis a eu les honneurs d’une page entière dans le 7ème Soir, supplément du journal Le Soir. L’association, en tant que telle, fut créée en 1996 ; j’ai alors publié un livre, intitulé Pomone jodognoise, qui reprend toutes les variétés obtenues dans le canton de Jodoigne, avec descriptions et photos. Enfin, dans les années 2000, nous avons mis au point le système des co-gestionnaires dans le verger, après les dix ans de Flore & Pomone. Evelyne Kievits fut parmi les premières à l’inaugurer…“
Des co-gestionnaires pour l’entretien du lieu
“Je me souviens très bien de l’article du Soir, enchaîne Evelyne Kievits qui est devenue une bénévole assidue de Flore & Pomone, je l’ai toujours. Je me rappelle aussi être venue à la grande fête des dix ans de l’association qui a eu lieu à la Ferme de la Ramée, en 1999. J’avais amené quelques pommes de mon grand pommier afin de les faire identifier…“

Un an plus tard, à la Sainte-Catherine de l’an 2000 – le 25 novembre – Flore & Pomone collabora à la plantation du Fruiticum de la magnifique ferme de l’abbaye de La Ramée, à Jauchelette, devenue depuis lors un lieu d’accueil pour séminaires très ‘haut de gamme’.
“Quant à moi, j’étais alors sans travail, se remémore Evelyne, et je me suis intéressée à la co-gestion que propose l’association, un système qui consiste à adopter des lignes du verger et à s’engager – par convention ! – à les entretenir afin que tout arbre puisse donner son meilleur. Tout cela sans visée productiviste, dans le respect de la variété et de la beauté de l’arbre. J’ai commencé par deux lignes puis, de fil en aiguille, comme d’autres lignes voisines n’étaient pas en très bonne forme, j’en co-gère à présent six ! Les lignes de plantation -numérotées de 1 à 9 – sont divisées en une dizaine de segments de dix mètres de long -représentés par des lettres. Le nombre d’arbres par segment varie mais, chaque ligne faisant environ deux mètres cinquante de largeur, chacune des parcelles qu’entretiennent les co-gestionnaires font environ vingt-cinq mètres carrés. Il y a trois ans, une autre co-gestionnoire m’a fait remarquer que nous ne devions pas brûler les bois de taille.

Nous avons donc tenté de les broyer afin de remettre le broyat aux pieds des arbres. Je me suis alors documentée sur le BRF – le bois roméal fragmenté – et c’est comme cela qu’après les tailles, tout est à présent systématiquement broyé par la commune d’Orp-Jauche qui met aimablement à notre disposition personnel et matériel. Nous épandons alors le tout entre les lignes, en n’utilisant que des rameaux de moins de sept centimètres de diamètre, sans quoi il y aurait trop de bois mort. La force vitale du BRF se trouve dans l’aubier ; ce bois va être progressivement attaqué par les champignons qui créent ainsi un réseau qui capte l’azote du sol. Une faim d’azote doit toutefois être compensée par l’apport d’adventices ou d’orties, ou même par un peu de compost. Mais, en général, le problème se résout de lui-même, et le grand avantage du procédé réside dans le fait que les champignons vont métaboliser le carbone et le rendre aux plantes, ou lieu de l’envoyer dans l’atmosphère. C’est une très belle technique qui fut mise au point ou Canada, il y a plus de vingt ans déjà.“
Choisir des variétés qui permettent d’étaler la production
“Les pommes sont plus faciles à gérer que les poires, explique alors Françoise Von Roozendael. Une poire cueillie trop tôt ne mûrira jamais ; il faut cependant la cueillir quelques jours avant de la manger et la laisser mûrir sur un plateau pour obtenir une chair vraiment succulente. Une pomme, par contre, peut être mangée aussitôt qu’elle est mûre. Il y a donc une question de feeling et de connaissances qui rendent les poires plus difficiles d’approche mais aussi plus passionnantes. Les variétés que nous trouvons au verger sont très différentes ou niveau du goût mais également du point de vue de leur culture. Et je le répète, le moment du mûrissement est très important. Concernant les pommes, il va de la fin août, pour les pommes d’août, à la fin octobre. Il faut même conseiller, pour certaines, de les laisser plusieurs mois dons un fruitier avant qu’elles soient vraiment agréables à manger. Évidemment, c’est une chose très compliquée dans notre monde moderne. Le rôle pédagogique d’une association telle que la nôtre est donc très important car il nous revient d’expliquer tout cela aux gens qui nous visitent. Nous conseillons donc à ceux qui souhaitent installer un petit verger chez eux d’opter pour des variétés qui permettent d’étaler la production dans le temps.“

“Certaines variétés, poursuit Jean-Pierre Wesel, notamment en haute tige, ne peuvent être conservées que trois jours. Pour un arbre qui peut donner jusqu’à trois cents kilos, cela peut être très difficile à gérer. Celui qui choisit d’installer des hautes tiges doit, par conséquent, choisir des variétés qu’on peut conserver pendant plusieurs mois. Conférence, par exemple, est une variété très connue de poires qu’on trouve dans nos magasins de grandes surfaces, mais c’est parce qu’elle se conserve pendant des mois dans des chambres où l’air est contrôlé et l’oxygène diminué. Chez vous, dans un fruitier même de la meilleure qualité possible, vous ne parviendrez à la conserver que trois semaines au maximum. Je conseille donc toujours de ne pas mettre plus d’un arbre, d’autant plus qu’elles sont bien meilleures lorsqu’elles mûrissent sur l’arbre. Conférence, c’est donc très bien, mais en petites quantités uniquement et dans le jardin familial.“
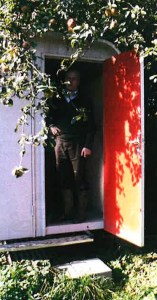
L’installation des ruches de l’apiculteur Geert Groessens complètent parfaitement l’écosystème verger. Eiles sont installées dans une roulotte afin d’optimaliser la protection contre le vent. “La roulotte permet également de déplacer aisément les ruches, explique Geert, car il est évidemment impossible de construire quoi que ce soit sur un terrain agricole. Moi, je pratique une apiculture qui est très respectueuse de la vie de l’abeille : ici, les ruches sont encore de type classique mais, dès l’année prochaine, j’expérimenterai des ruches à caractère plus apicentriques, de type Warez notamment.” “Un rucher dans un verger, cela double la récolte“, conclut alors fièrement Jean-Pierre Wesel.
Les projets de Flore & Pomone
“Nous avons été récemment contactés par la NBS (Nationale Boomgaardenstichting), raconte Françoise van Roozendael, dans le but de nous associer à un projet de coopération régionale appelé Ontmoet je buren (Rencontre tes voisins), subsidié au niveau de l’Europe. Nous sommes, en effet, situés ou cœur d’une région naturelle, toute semblable ou niveau sol, qui comprend, côté flamand, le Hageland (région de Tirlemont, Diest) ainsi que le pays d’Haspengouw (la partie limbourgeoise de la Hesbaye, région de Saint-Trond, Tongres, Bilzen) et, côté wallon, cette région de la Hesbaye brabançonne où nous nous trouvons. Si tout fonctionne, le projet se déroulerait sur deux ans et se clôturerait, en 2014, avec une grande exposition de fruits. Cela coïnciderait avec nos vingt-cinq ans et s’inscrirait parfaitement dons notre grand projet de diffusion de variétés locales, de poires notamment.“
“Nous avons, par exemple, une variété de pomme typiquement locale qui s’appelle Jérusalem, dit Jean-Pierre Wesel. Mon hypothèse est qu’elle provient d’un ancien verger des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui avaient une commanderie très importante à Huppaye. On trouve la pomme en question dons des vergers situés aux alentours, ainsi que du côté de Wavre où se trouvait également une commanderie. Nous avons retrouvé des greffons de Jérusalem que nous allons maintenant essayer de multiplier. Le monde de la pomologie est très vaste et formidablement enthousiasmant.“

Précisons que l’association organise régulièrement des séances d’entretien du verger, au printemps et à l’automne. Pour en savoir davantage, consultez le site Internet de Flore & Pomone (floreetpomone.be), ou écrivez à Françoise van Roozendael, rue de Mazy 46, à 5030 Gembloux (pomone@scorlet.be).
Dominique Parizel
[INFOS QUALITE] statut : validé | mode d’édition : dématérialisation, partage, correction, édition et iconographie | sources : Valériane n°99 | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : © Dominique Parizel ; © Flore & Pomone ; © Keepers Nursery | Jean-Pierre Wesel est le père de deux artistes présents dans notre encyclo : Thierry Wesel et Bénédicte Wesel.
Plus d’écoumène en Wallonie…
- WESEL : Le fruiticum, héritier d’une tradition monastique et d’une spécialité du Pays de Jodoigne (2002)
- LEBRUN : Souvenirs de chasse (1912-1920)
- LEFEVERE S., La crevette grise (IRSN, 1960)
- D’où vient ce chiffre de 15.000 litres d’eau nécessaires pour produire 1 kg de viande de bœuf ?
- L’esplanade AC/DC voit enfin le jour à Namur…
- LEMPEREUR : L’arbre dans le patrimoine culturel immatériel (2009)
- LIBERT & KATTUS : Passage du Laitier (Cointe, Liège)
- VÉLOTAF : ne dites pas “autoroute vélo”, mais “cyclostrade”
- FRECHKOP S., Animaux protégés au Congo Belge (Institut des parcs nationaux du Congo belge, Bruxelles, 1953)
- GODEAUX : Le tram et le trolleybus de Cointe (CHiCC, 2003)
- RUWET : Les carnets de chasse de Georges Lebrun au Congo belge (1912-1920)




